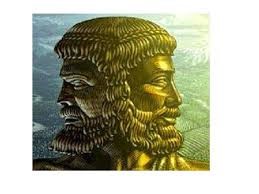Par Jacque
De l’eumétrie à la phronésis en passant par l’otium, l’individuation et le pathique
L’eumétrie ou la distance et proximité suffisamment bonnes
La distance sans le lien introduit l’indifférence. Le lien sans la distance introduit la dépendance. Le lien et la distance conjugués introduisent l’ouverture de soi à ce que vit l’autre, sans être submergé, sans se laisser submerger et sans submerger l’autre par nos « bons » sentiments !
Le piège de la distance, c’est l’indifférence et la banalisation. Le piège du lien, c’est l’emprise de notre subjectivité. Deux pièges sont donc à éviter : l’un consiste à se blinder et tenir à distance les plaintes, jusqu’à ne les entendre que comme un murmure habituel, ce qui est le propre de l’indifférence organisée. L’autre de s’y noyer avec le « souffrant » parce que nous sommes pris dans les rets d’une relation fusionnelle. Bruno Humbeek[1] nous en parle en termes d’« eumétrie » :
« L’eumétrie c’est la juste distance…celle qui permet de s’écarter du monde en demeurant concerné par ce qui s’y vit. Celle qui invite à cultiver la discrétion en restant néanmoins présent. Celle qui incite à nourrir des relations fluides tout en préservant son aptitude à se détacher. L’eumétrie c’est la capacité de se rendre disponible pour les autres sans jamais s’exposer au risque d’être envahissant parce qu’on se pense indispensable. L’eumétrie c’est l’aptitude à se sentir intéressé par ce que vivent les autres sans jamais s’en soucier au point de se montrer intrusif. L’eumétrie, c’est l’art de mettre le juste milieu entre soi et les autres pour s’autoriser à se sentir singulier en demeurant résolument soi-même au milieu de ses semblables. L’eumétrie, c’est avoir fait suffisamment de provisions affectives dans son âme pour pouvoir tenir un long siège enfermé dans un endroit qui nous tient à l’abri de tous les regards sans éprouver l’impression de manquer de quoi que ce soit… L’eumétrie c’est la distance qui, ni trop près ni trop loin, aide à éviter de mettre en péril le noyau dur de son identité parce qu’on se serait exclusivement laissé modeler par le regard des autres, qu’on se serait conformé trop strictement à leurs attentes ou que l’on aurait attaché trop d’importance à l’image que l’on donne de soi. »[2] Et quand est-il de la rencontre avec soi et avec l’autre ? Le retour à soi ou l’otium nous y invite.
Le retour à soi ou l’otium

Five people having fun sitting on pier. Feet shot from below the pier. Sunny summer day evening.
Nikon D850
Otium est un mot d’origine latine qui désigne un état où l’on cesse d’agir, un état de ce qui est calme, tranquille. L’otium peut être défini comme un « loisir studieux », qui peut se traduire par une quête de sens et de beauté. Selon les principes de l’otium, le plus important est de profiter du temps désintéressé qui s’offre à nous pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et façonner notre liberté d’esprit. C’est un temps consacré à la rencontre, à la rencontre d’amis, à la lecture, à la philosophie, la méditation, etc. L’otium est le temps du loisir libre de tout negotium, de toute activité liée à la subsistance : il est en cela le temps de l’existence.
Le negotium est l’inverse d’otium. Negotium signifie occupation, travail, affaire, négoce. D’origine latine, également, le mot « négoce » vient de nec otium, c’est-à-dire la négation du loisir. Le « negotium » est le nom que les Romains donnaient à la sphère de la production. C’est le commerce au sens large des affaires, le « business ».
Nous sommes envahis par le negotium, le négoce et nous luttons beaucoup avec nous-mêmes contre cet otium, pour nous interdire ce temps soi-disant improductif. Nous sommes également envahis par les réseaux sociaux. Le soi réel est désormais prolongé et même débordé par le soi virtuel. Notre présence à soi est mise à distance ! Il serait donc nécessaire de « mettre en place une éthique du débranchement, de la déconnexion comme art de vivre ses journées. Mais c’est là précisément une solution éthique, individuelle et non politique ou collective ».[3]Comment trouver son équilibre et son autonomie psychiques dès lors ?
» your text Trouver son équilibre et son autonomie psychiques c’est passer à ce que l’on peut appeler « la conscience réfléchie ». Au cours de cette étape, nous apprenons à faire le tri entre nos désirs, nos projets, nos pensées, nos émotions… Nous devenons ainsi plus libres parce que nous nous détachons de nos désirs confus et contradictoires. Nous constatons que nous étions aveuglés par des fantasmes, des imaginations irréalistes où tout tournait uniquement autour de nous-mêmes et de notre supposée grandeur. Ensuite, nous nous réalisons, parce que nous parvenons à des choix où nos aspirations s’accordent à la vie en société. Il s’agit en fait de choisir « avec » les autres, sans pour autant nous soumettre passivement à leur domination. L’équilibre de la personne ne résiderait-il pas dans notre capacité à accepter nos antinomies ? Précisons maintenant le concept de l’autonomie. Être, devenir autonome psychiquement « Autonome » vient du grec »autos » : soi-même et « nomos » : loi, règle. L’autonomie est la faculté d’agir par soi-même en se donnant ses propres règles de conduite, sa propre loi. C’est la capacité à agir par soi-même, à choisir par soi-même et à penser par soi-même. Devenir autonome c’est pouvoir fonctionner selon les normes que l’on se fixe soi-même et exige donc une certaine dose de maturité. L’autonomie est donc définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité de jugement, c’est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s’exercer dans le respect des lois et des usages communs. L’autonomie d’une personne relève ainsi à la fois de la capacité et de la liberté. L’autonomie affective se traduit par la capacité de subvenir à ses propres besoins émotionnels. L’amour, la chaleur humaine, l’attention, la tendresse, la patience, l’empathie et la joie sont quelques-uns des ingrédients de cette nourriture émotionnelle nécessaire au développement d’une autonomie émotionnelle. L’indépendance affective est cet état dans lequel une personne a suffisamment d’amour d’elle-même pour ne plus être dépendante de l’amour des autres. Ce que j’en dis, entre autres, dans mon livre « Prendre soin de soi et de l’autre en soi[4] » à la page 94. « Il appartient à chacun de ne pas s’abuser et de cesser d’accuser autrui d’être le responsable de sa souffrance ou de ses manques. Passer de la victimisation à l’affirmation, et donc à la responsabilisation, suppose qu’on accepte de ne plus se complaire dans la dépendance ou l’impuissance. Accéder à la reconnaissance de ses blessures et de ses besoins, apprendre à développer des capacités d’autonomie et de prise en charge personnelle, des moyens visant à satisfaire ses propres besoins, telles sont les bases d’une liberté d’être à la fois plus centrée et plus ouverte. Cette responsabilité de conscience constitue un pas essentiel vers le respect de soi. »[5] Le « processus de séparation-individuation » est indispensable à l’autonomie. Mais qu’est-ce que l’individuation ? Le processus d’individuation À la page 58 de mon livre : “L’individuation n’a d’autre but que de libérer le Soi, d’une part des fausses enveloppes de la persona, et d’autre part de la force suggestive des images inconscientes”. C’est un chemin, un processus de transformation qui consiste en une prise de conscient de plus en plus étendue et à une obéissance au Soi. »[6] « La philosophie grecque a forgé un très beau concept : la métanoïa[7], cet effort sur soi, cette conversion intime qui visent à se transformer radicalement pour embrasser un art de vivre apte à nous préserver des passions tristes, des réflexes, de l’égoïsme, de la prison des habitudes. Avancer, progresser, se délester de ce qui alourdit, se libérer, pour les autres et donc pour, le monde tout entier. »[8] Ainsi, la réalisation du Soi est la condition sine qua non de notre liberté. À la page 30-31 : L’individuation se fait à partir des autres et moyennant la réalité de l’autre comme autre. « L’individuation psychique, cela implique au moins quatre dimensions : la capacité de soutenir une identité, de l’assumer ; cela suppose une capacité d’existence psychique par soi-même ; une capacité de relation avec les autres ; et enfin, une capacité d’être en société, de jouer le jeu du collectif. »[9] À la page 12 : « C’est l’individuation psychique qui fait des humains des êtres pour eux-mêmes, des êtres d’action et des êtres pour les autres, des êtres en société. Autant de registres qui ne vont nullement de soi, qui ne sont nullement donnés par la nature, qui relèvent de processus de constitution problématiques puisque payés dans tous les cas de lourdes séquelles qui nous hantent d’une manière ou d’une autre. »[10]Approfondissons maintenant la question du juste milieu. Le juste milieu Retrouver le juste milieu, c’est réintroduire du tiers, l’inclure au lieu de l’exclure. C’est le « et » au lieu de « ou », « ou bien », le « nous » en place et à côté ou après le « je ». Nous retrouvons ce concept dans celui de l’espace transitionnel. Tout espace transitionnel sert à créer du lien, constitue un espace de partage, une aire solidaire opposée à l’individualisme, le « nous » opposé au « je fais ce que je veux, je suis ce que j’aime ». Le lecteur trouvera un développement plus approfondi dans mon livre « Prendre soin de soi et de l’autre en soi » à la page 145-159. Trouver, chercher le juste milieu c’est aussi et surtout faire, non seulement ce travail d’élaboration de la pensée, mais aussi celui opéré par la symbolisation (cf. le jeu de la bobine), qui permet de surmonter le traumatisme de la séparation p.ex. Le jeu (représentation scénique p.ex.) constitue un véritable chaînon manquant entre la décharge et la pensée. Qu’est-ce que le « milieu » ? Ce terme vient de Mi et Lieu. En général, il s’agit de tout endroit qui est éloigné de la circonférence, des extrémités. Le lieu est distant des extrémités. C’est la partie moyenne d’une durée entre le commencement et la fin. C’est un intermédiaire. Le dictionnaire Le Littré[11] définit, entre autres, le milieu comme « tout corps, soit fluide, soit solide, qui peut être traversé par un autre corps, spécialement par la lumière. L’air, l’eau, le diamant sont, pour la lumière, des milieux qui la réfractent diversement en vertu de leur densité différente ». L’air est le milieu dans lequel nous vivons. L’eau est le milieu où vivent les poissons. Les antonymes de « milieu » sont : extrémité, bordure, écart … Que veut dire « juste » ? Ce mot vient du latin justus et désigne « qui est conforme au droit, à la raison et à la justice ». C’est ce qui est fondé, exact, légitime, qui s’accorde bien, qui cadre. Dans l’ancien français, jus est le nominatif masculin, juste est le régime. Justus est considéré comme une autre forme de jussus, participe passif de l’ancien verbe jussere ; il signifierait proprement : ordonné, prescrit. Ses antonymes sont : abusif, inexact, erroné, faux, inéquitable …comment se mettre en marche dans un milieu choisit comme juste en toute autonomie ? Un détour par la question du désir s’impose ici. Ce que nous dit Silvia Lippi du désir « Le désir est conatus[12], effort de persévérer dans son être. Désirer est comme naviguer, d’après Freud, et naviguer est plus nécessaire que vivre. »[13] « Le sujet désire à partir de la force d’exister, qui est, paradoxalement donnée par le manque à être. Le manque à être est une notion dynamique, que Lacan avait voulu traduire en Anglais par want to be, car si l’inconscient n’est pas, il veut quelque chose »[14]. « Le sujet désire à travers un sentiment de joie et de puissance. La puissance n’est pas le pouvoir : elle permet au sujet de se confronter au manque, sans vouloir le combler. La puissance fait du manque une force, une ouverture. Ouverture à l’inconscient, à l’inattendu, à l’autre. »[15] « Décider de son désir révèle en effet une forme propre à une logique assertive[16] ». J’en profite ici pour faire un lien avec le concept de l’« assertivité » qui est très utile dans la pratique psychothérapeutique et sera approfondi dans le paragraphe suivant. En quelques mots l’assertivité est une compétence sociale et communicative qui permet de vivre en harmonie avec soi et avec les autres. Autres affirmations de Silvia Lippi : « La joie est « attente », une attente « inattendue ». On jouit de l’attente, dans le désir : « Indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente qui est magnifique écrit Breton. C’est comme dans le processus qui conduit à l’acceptation de la castration, le sujet se veut tout-puissant et il se retrouve castré, et il sera, à sa grande surprise, soulagé par cet état. La castration n’est pas la catastrophe, mais le moteur insoupçonné du désir. »[17]Le désir, c’est donc le désir d’un manque, un manque induisant que ce qui nous manque, nous l’avons déjà eu dans le passé, réellement ou de façon fantasmatique. Il implique donc une régression, un désir d’avant. C’est pour cela aussi qu’un certain nombre d’entre nous ont tendance à dire « c’était mieux avant ».[18]Précisons maintenant le concept de l’assertivité. « Le mot vient du mot anglais « Assertiviness » initié par Andrew Salter psychologue new-yorkais dans la première moitié du siècle dernier. Développé plus récemment par Joseph Wolpe, psychiatre et professeur de médecine américain comme « Expression libre de toutes émotions vis-à-vis d’un tiers, à l’exception de l’anxiété ». L’assertivité est définie comme une attitude dans laquelle on est capable de s’affirmer tout en respectant autrui. Il s’agit de se respecter soi-même en s’exprimant directement, sans détour, mais avec considération. Cela conduit à diminuer le stress personnel, à ne pas en induire chez autrui et à augmenter l’efficacité dans la plupart des situations d’entretien. Cette attitude est particulièrement importante dans toutes les situations de la vie, mais elle l’est particulièrement dans toutes les situations d’entretiens professionnels et notamment dans le management (domaine où elle est trop souvent ignorée). L’assertivité permet une certaine autonomie. Et l’autonomie psychique plus précisément est également liée à une visée de l’humanité. Éthique, responsabilité, coût, choix et engagement J’explore ici la notion d’éthique, tant sur le plan personnel que professionnel, en mettant l’accent sur la responsabilité, l’engagement, et les choix qui en découlent. L’éthique est une visée essentielle de l’humanité, une réflexion sur l’action humaine, enracinée dans la volonté de préserver la dignité, la vie et l’équilibre environnemental. Sur le plan personnel, je dénonce les dérives du technocapitalisme, qui, dans sa quête de profit immédiat, engendre destruction écologique, épuisement humain et inégalités alimentaires. Je plaide pour une réorientation de la production vers des modèles durables, locaux et éthiques, comme l’économie circulaire et les exploitations familiales. L’éthique devient alors un acte de résistance à l’industrialisation aveugle et à l’anthropocentrisme, en appelant à une gouvernance responsable, solidaire et tournée vers la préservation de la biodiversité. Dans le cadre professionnel, notamment thérapeutique, l’éthique repose sur cinq principes : réflexion sur l’action (question du sens et des valeurs), respect de la singularité de la personne, vision positive de l’humain, acceptation des contradictions internes, et approche éclectique nourrie par diverses références théoriques (de Szondi à Jung, Freud ou Marc Ledoux). Je propose une éthique humaniste, orientée vers le développement des potentialités et la co-construction du soin avec la personne, bien au-delà de l’application mécanique de techniques. En conclusion, l’éthique est à la fois un fondement et un horizon de l’existence humaine. Elle appelle à penser et agir avec lucidité, responsabilité, et espoir, face aux enjeux contemporains aussi bien individuels que collectifs. Voyons ce que la phronésis nous apprend à ce sujet. La phronésis est un concept issu de la pensée d’Aristote. Cette vertu désigne le flair dans l’action, l’art de s’adapter aux circonstances, la sagacité de celui qui discerne le bon chemin à prendre dans le clair-obscur du réel. C’est une intelligence pratique, avec sa rationalité, mais aussi avec sa part mystérieuse d’intuition, de finesse et de vivacité d’esprit[19]. Elle enseigne le fait d’être l’artisan de sa propre vie. « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action »(Bergson).[20]Vertu du « coeur intelligent »[21]. Elle est juste mesure[22]. La Phronésis vise L’Histoire, non la story[27] ! La phronèsis possède bien une dimension éthique puisqu’elle vise selon Aristote la recherche du bien commun.[28] La phronèsis c’est aussi la noblesse des renoncements[29]. Le phronimos est serein, non grâce à l’absence de danger, mais parce qu’il fait confiance à ses ressources pour le tirer d’affaire. Il le sait : les aléas traversent le monde, de nouvelles tempêtes surgiront toujours. Mais sa phronèsis est une clé de la tranquillité d’âme[30]. Dans un monde techno-numérique où la prise de décision est soumise à l’algorithme, quelle place reste-t-il à la phronèsis ?[31] La phronèsis fait battre le coeur intelligent de l’homme, ce qu’aucune machine, si puissante soit-elle, ne pourra jamais remplacer[32]. Tout cela nous ramène à la question de la santé psychique. « La santé psychique, justement, c’est quelque chose qui doit se décider, se conquérir à tout moment, qui est aussi toujours relatif à une histoire, à un milieu et, finalement même à une décision prise en commun par un patient, un homo patiens qui vit cette condition pathique[33], et un éventuel thérapeute, étant entendu que toujours, chacun est aussi son propre thérapeute : l’homme c’est l’animal malade, mais aussi auto thérapeutique. »[34] Je citerais ici les propos de Moussa Nabati dans son livre « Guérir son enfant intérieur »[35] dans la partie « Le plaisir de vivre » à propos de la biologie de l’espoir : « C’est là qu’une bonne et efficace psychothérapie délivrante-donnant l’envie de vivre-, autorisante, peut-être utile. Je ne dis pas et ne pense pas que seuls les égoïstes guérissent ! Mais il y a des limites aux droits d’autrui sur soi, une limite entre soi et autrui. …Lorsque le patient, de par son évolution personnelle avec l’aide d’une psychothérapie, devient une personne, une personne à part entière, et s’autorise ou s’accorde les petits et grands plaisirs de la vie, s’accorde le droit au temps et à l’espace, à ses désirs et à sa créativité, à lâcher ses rôles néfastes et son identification, sa loyauté invisible familiale – met de côté sa culpabilité et cesse de « payer pour vivre » -, on voit souvent des améliorations spectaculaires. S’autoriser à se faire plaisir, devenir soi, « s’éclater » dans la joie et le bonheur est une nourriture du corps et de l’âme. Ce plaisir de vivre et d’être, de plénitude, cela peut être le bonheur de petites choses, comme la joie de vivre, de respirer, de voir le ciel bleu, d’exister, simplement, d’être reconnu, d’aimer et d’être aimé…tout se passe comme si c’était une nourriture de l’âme et du corps, une nourriture affective transformante, la « biologie de l’espoir » transformant réellement la biologie du corps, son immunologie, ses réactions, et permettant ainsi de retrouver un meilleur fonctionnement biopsychocorporel, donc une meilleure santé, et parfois la vraie bonne santé – et la vie. » Ce qui vient d’être énoncé ressemble fort à la citation de Voltaire : « j’ai décidé d’être heureux, car c’est bon pour la santé » ! J’ajouterais que cette forme de bonheur n’a aucun effet secondaire indésirable ! Je conclurais en reprenant celle de mon livre qui me semble pertinente : « Commencer par soi, mais non finir par soi ; se prendre pour point de départ, mais non pour but ; se connaître, mais non se préoccuper de soi. »[36] Toute vie véritable est rencontre avec soi et avec l’(A) autre. Cette rencontre est celle du circuit créatif et non pas celle du circuit pulsionnel. La rencontre thérapeutique est ce qui fait que les choses ne seront plus les mêmes ensuite. Nous pouvons sortir du déterminisme habituel induit par le système médical notamment et décider de son propre désir, créer quelque chose ensemble, cocréer, passer à une conscience réfléchie, se relier à soi, être soi en présence et en l’absence de l’autre et ce grâce à la recherche d’un espace psychique propre qu’il soit individuel ou groupal. Prendre soin de soi et de l’autre en soi sera favorisé par la découverte inédite du triangle pronominal des trois « S’A » et celle du circuit pronominal des quatre « S’A ». Les quatre verbes pronominaux de ces deux schémas innovants traduisent une action précise et permettent au processus d’individuation psychique et à la construction identitaire de s’accomplir. S’appartenir c’est se tenir à part, être maître de soi et devenir librement autonome. S’accompagner c’est « être », être son meilleur compagnon, aller vers un renouveau, un nouveau « vous », un nouveau soi, et utiliser ses propres ressources dans un espace cocréatif, privilégié et singulier qu’est la psychothérapie. S’avoir c’est voir « ça » c’est-à-dire composer avec l’Autre, l’inconscient, ce par quoi nous sommes constitués, le lieu psychique de « l’autre scène ». S’avoir va permettre une reprise en main de soi grâce au processus introjectif lui-même et pose la question suivante : « qui suis-je ici et maintenant dans mon corps et avec mes limites ? » pour y répondre par un travail sur soi constructif. Enfin le quatrième élément « s’autoriser » qui vient compléter le triangle pronominal pour le transformer en circuit des quatre « S’A » signifie, quant à lui, chercher la permission d’être ce que nous sommes, oser, se permettre, se donner le droit d’être, d’exister pleinement en éprouvant du plaisir, sans honte et culpabilité, mais aussi avec nos failles. Ces deux schémas psychothérapeutiques originaux, grâce à la fonction tierce symboligène, source de nouvelles symbolisations, exercées dans le registre du pathique, vont permettre, par le dire s’adressant à l’autre, que l’inédit vienne s’éditer ! »[37] Mots-clés : La santé psychique, l’eumétrie, l’otium, l’individuation, le pathique, l’autonomie psychique, le juste milieu, le désir, l’assertivité, l’éthique, le circuit pronominal des quatre « S’A ». [1]Titulaire d’un Master européen de Recherche en Sciences de l’Éducation et d’un doctorat en Sciences de l’Éducation de l’Université de Rouen, Bruno Humbeeck est actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du service des Sciences de la famille de l’Université de Mons. [2]Bruno Humbeek, psychopédagogue, article Linkedin, https://www.linkedin.com/posts/bruno-humbeeck-95714930_leum%C3%A9trie-cest-la-juste-distance-celle-activity-7273652136985464832-_rS1/?originalSubdomain=fr [3]Guillaume Le Blanc, philosophe,in article Le Vif, 29 mai 2025 [4]Jacques Michelet, Prendre soin de soi et de l’autre en soi, Ed. L’Harmattan, septembre 2020. [5]Ibidem, p.211. [6] http://www.geopsy.com/cours_psycho/psycho_analytique.pdf [7]C’est moi qui précise ici son étymologie : Étymologiquement, le mot « métanoïa » provient du grec méta (préfixe signifiant le changement, la succession, le fait d’aller au-delà, ce qui nous dépasse, induisant une idée de transformation) et noïa (de noos ou noüs : esprit, idée). [8]Alexandre Jollien, Christophe André, Matthieu Ricard, A nous la Liberté ! L’Iconoclaste et Allary Editions, Paris, 2019, p. 13. [9]Marcel Gauchet, pour une théorie psychanalytique de l’individuation in se construire comme sujet, sous la direction de Karl-Leo Schwering, Ères 2012, p.24. [10] Ibidem, p.18. [11] https://www.littre.org/definition/milieu [12]Chez Spinoza, conatus est le participe passé du verbe latin conor, qui signifie littéralement « se mettre en marche », « entreprendre », « essayer » ou encore « être disposé, « se préparer, « se mettre en état ». Dans le désir décidé, il y a la jouissance qui « cède » et l’acte qui « coupe ». Voyons l’étymologie latine du verbe « décider ». Decidere en latin a deux significations différentes : decido signifie « tomber », « choir » (de-cado- : « chuter, « tomber ») et aussi « trancher » (de-caedo : » frapper », « briser »).La décision du désir, Silvia Lippi, Editions Erès 2013, p.37. [13]Ibidem, p.260. [14]Ibidem, p.266. [15]Ibidem, p.267. [16]Ibidem, p.264. [17] Ibidem, p.268. [18] Silvia Lippi, La décision du désir, Editions Eres, 2013. [19] Catherine Van Offelen, Risquer la prudence, Ed.Gallimard, 2025, p.12. [20] Ibidem,p.89. [21] Ibidem, p.12. [22] Ibidem,p.83. [23] Ibidem, p.29. [24] Ibidem, p.79. [25] Ibidem, p.31 [26] Ibidem, p.166. [27] Ibidem, p.35. [28] Ibidem, p.60. [29] Ibidem, p.104. [30] Ibidem, p.133. [31] Ibidem, p.161. [32] Ibidem, p.164. [33] Je précise ici que le pathique est une communication immédiatement présente, intuitive-sensible, encore préconceptuelle, que nous avons avec le monde. Le champ du « pathique » est celui qui renvoie le malade à ce qu’il peut, à ce qu’il veut, à ce qu’il doit ou ose devenir ! Ce concept est développé plus loin, dans la deuxième partie de mon livre, avec l’intitulé « Diagnostic et psychiatrie ». [34]Jacques Schotte, Un Parcours, Editions Le Pli, 2006, p.305-306. [35]Moussa Nabati, Guérir son enfant intérieur, Ed Fayard, 2008, p.196-197. [36] Buber Martin, Le chemin de l’homme. Editions du Rocher, 1999. [37] Jacques Michelet, Prendre soin de soi et de l’autre en soi, Ed. L’Harmattan, septembre 2020., p.259. » your text 09 janvier, 2026 Le juste milieu ou le tiers inclus
La phronésis
La phronèsis révèle à la fois la sensibilité de la raison et l’intelligence des émotions[23].
Elle confond dans une même opération voir, sentir et savoir, rassemblant l’esprit scientifique, affectif et intuitif sous une bannière unique[24].
La phronèsis est l’art d’agir dans un monde flou[25]. Elle est clairvoyance et bon sens.
Flair, hauteur de vue, courage, imagination, sens du kairos, savoir attendre, savoir agir serait les traits rassemblés de la phronèsis. La phronésis nous apprend à distinguer les deux versants du risque, visages de Janus devant lesquels l’homme oscille avant de franchir le seuil[26].La santé psychique
CONCLUSIONS
VOUS DEVRIEZ EGALEMENT AIMER CEUX-CI !
Le « mensonge », cet « acte parlé »