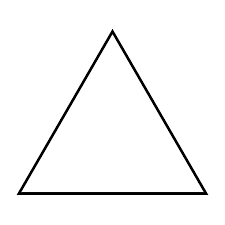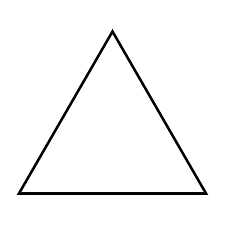Par Jacque
 La clinique victimaire est une clinique dominée par le mécanisme de l’itération négative, le masochisme moral, la cruauté du surmoi et le sentiment d’une existence exceptionnellement invalidante. En exhibant sa victimité chacun pense avoir trouvé son victimaire. Il y a aujourd’hui un plaisir « énigmatique et inintelligible », pour reprendre l’expression de Freud [i] concernant le masochisme, à « se voir en victime »[ii] . Souvent dans la clinique victimaire, on retrouve des préoccupations psychiques liées à la culpabilité, au négatif et à la répétition mortifère et destructrice. La personne « victime » est, en effet, enfermée et engloutie dans un cercle effroyable où la culpabilité précède et suit à la fois un comportement social parfois tout à fait anodin. Assurément, la compulsion de répétition, qui se situe au-delà du principe de plaisir, paraît essentielle dans l’agir compulsif d’échec. Cet agir négatif et mortifère, si temporairement il soulage la personne, secondairement la culpabilise. C’est dans ce sens que Freud (1932) écrivait : « Il y a des gens qui répètent toujours, à leurs dépens, les mêmes réactions sans les corriger ou qui semblent eux-mêmes poursuivis par un destin inexorable alors qu’un examen plus précis nous enseigne qu’eux-mêmes sans le savoir, se préparent ce destin. Nous attribuons alors à la compulsion de répétition le caractère démoniaque. »[iii] La compulsion de répétition « mortifère » semble tirer son origine de l’étouffement initial du moi qui désormais demande une intense réparation narcissique d’un préjudice précoce.
La clinique victimaire est une clinique dominée par le mécanisme de l’itération négative, le masochisme moral, la cruauté du surmoi et le sentiment d’une existence exceptionnellement invalidante. En exhibant sa victimité chacun pense avoir trouvé son victimaire. Il y a aujourd’hui un plaisir « énigmatique et inintelligible », pour reprendre l’expression de Freud [i] concernant le masochisme, à « se voir en victime »[ii] . Souvent dans la clinique victimaire, on retrouve des préoccupations psychiques liées à la culpabilité, au négatif et à la répétition mortifère et destructrice. La personne « victime » est, en effet, enfermée et engloutie dans un cercle effroyable où la culpabilité précède et suit à la fois un comportement social parfois tout à fait anodin. Assurément, la compulsion de répétition, qui se situe au-delà du principe de plaisir, paraît essentielle dans l’agir compulsif d’échec. Cet agir négatif et mortifère, si temporairement il soulage la personne, secondairement la culpabilise. C’est dans ce sens que Freud (1932) écrivait : « Il y a des gens qui répètent toujours, à leurs dépens, les mêmes réactions sans les corriger ou qui semblent eux-mêmes poursuivis par un destin inexorable alors qu’un examen plus précis nous enseigne qu’eux-mêmes sans le savoir, se préparent ce destin. Nous attribuons alors à la compulsion de répétition le caractère démoniaque. »[iii] La compulsion de répétition « mortifère » semble tirer son origine de l’étouffement initial du moi qui désormais demande une intense réparation narcissique d’un préjudice précoce.
» your text Notons que les dommages anciens sont situés essentiellement sur l’axe de l’avoir. Ainsi, la personne estime avoir été « privée » d’un avantage qu’elle était en droit de recevoir (amour, nourriture, soins, …). Elle pense avoir été très tôt « lésée » et infériorisée d’où sa condition de victime « sans fin ». D’une certaine manière, la répétition négative et « commémorative » d’un sujet justifie sa situation originaire d’être victime perpétuant de la sorte un statut d’exception a priori déplaisant qui n’est toutefois pas dépourvu « d’une jouissance par lui-même ignorée ». La jouissance où se mêlent plaisir et douleur, se situe, en effet, dans un « au-delà du principe de plaisir ». Elle intéresse le désir et plus nettement le désir inconscient. L « ’installation » dans un statut de victime peut se présenter sous la forme du schéma suivant appelé : Grève : la grève est intrinsèque à la dépression par absence de plaisir. Il y a grève de l’action, du contact, de l’expression, de la spontanéité et du plaisir. C’est la goutte qui fait déborder le vase. Et n’oublions pas que c’est nous qui remplissons ce vase ! Bouderie : la bouderie est plus compliquée à arrêter. Une partie de nous, de notre narcissisme se refuse à changer. Le boudeur se prive de beaucoup de choses. Mémorial de souffrance : l’évènement est vécu comme tellement injuste qu’il faut que cela reste sanguinolent. Il faut montrer que ce qui arrive est grave et rouvrir les plaies. Aller mieux ce serait banaliser l’acte « injuste ». « C’est depuis que… ». La légitimité est sacralisée et il y a installation dans un statut de victime. S’enfermer dans un statut de victime permet de toucher des primes ! Etre malade équivaut à être passif et impuissant. La situation suivante illustre bien ce propos : deux voitures sont accidentées. L’ambulance arrive sur place. L’un des deux conducteurs monte dedans. L’autre ne veut pas y monter et défend une position légitime qui est celle de dire « je suis dans mon droit ». C’est l’autre qui n’a pas respecté le code de la route. « Je ne veux pas monter dans l’ambulance » (ce ne serait pas dans son intérêt d’aller dans l’ambulance puisqu’il est en droit ! En dépit de toute limite et de toute contrainte, les individus ont en général la possibilité de choisir et de décider de leur propre vie : l’être humain est autonome, et c’est son autonomie qui lui permet de se reconnaître comme l’acteur de sa vie et le sujet de son désir ; c’est l’autonomie qui permet au sujet de ne pas être réduit à une « chose » du monde à la libre disposition d’autrui ; c’est l’autonomie — qui dépend en partie des influences et des expériences que l’on a reçues ou vécues — qui permet de prendre position et de choisir selon un idéal, un projet, une vision spécifique du monde et de sa propre existence. Par ses désirs et par ses choix, chacun prend position dans le monde et s’engage vis-à-vis des autres. On peut se tromper et changer d’avis, revenir sur ses engagements et s’orienter dans le monde de façon différente. On peut, au contraire, tout faire pour sauvegarder la cohérence de son vécu. Ce qui cependant reste une constante, c’est le fait que les décisions que l’on prend et les choix que l’on accomplit ont toujours des conséquences ; c’est le fait que, à chaque fois qu’on agit, on répond de ses actes — d’où l’importance éthique du concept de responsabilité [iv]. L’autonomisation est une conquête, une lutte à mener contre ces premiers autres dont nous avons été dépendants mais aussi contre le Soi lui-même qui cherche toujours en même temps à s’épargner ces ressentis pénibles de séparation. Ce processus au long cours s’effectue par étapes successives. En bout de course, l’enfant et par la suite, tout au long de son existence d’adulte, doit pouvoir renoncer à l’espoir de recevoir pleinement de l’autre ce qu’il attend. Il s’agit pour lui de s’approprier pas à pas l’autonomie, dit-on, d’acquérir de l’indépendance. Cela suppose un deuil, douloureux, celui de ne plus attendre de l’autre qu’il comble ses désirs et ses besoins mais de prendre la responsabilité personnelle de les assumer soi-même. L’avantage obtenu est un gain indéniable de liberté mais aussi le fait de n’être plus parlé par un autre, d’assumer à son tour sa propre parole. »[v] Consacrer le fonctionnement victimaire empêche au sujet d’advenir. Sortir de ce triangle consistera à renvoyer à la responsabilité de l’autre c.-à-d. à la respon-habilité, aux compétences de l’autre, à recapaciter l’autre, rehausser l’estime de soi, rendre à la victime son statut de sujet. Quand la victime cicatrise et parvient à transformer sa douleur en combat, l’agresseur risque de paraître moins monstrueux. Il s’agira aussi de permettre d’entrer dans un autre monde de relation plus coopérative avec soi-même, ouvrir davantage l’imaginaire, favoriser une projection dans le futur…L’hypnothérapie peut être très utile ici. La psychothérapie qui est par essence « anti-traumatique », vise à modifier l’aménagement psychoaffectif du sujet dans l’optique d’une souffrance atténuée et d’une meilleure répartition de ses investissements. Il s’agit donc d’éviter la répétition stérile et malheureuse, en somme de faire disparaître les symptômes et de tempérer la férocité du surmoi. En définitive, l’analyse cherche ainsi que l’a indiqué Freud, à faire retrouver par la personne la capacité d’aimer et de travailler. [i] Sigmund Freud, (1924), « Le problème économique du masochisme », in Névrose, psychose et perversion, trad. franç. J. Laplanche, Paris, PUF, 1973, p. 287-97. [ii] . Cf. Charles Melman, (1994), « Déontologie du traumatisme », Journal Français de Psychiatrie, n° 1. [iii] . Sigmund Freud, (1912-1913), Totem et tabou, trad. M. Weber, Paris, Gallimard, 1993. ., p. 292, n°1. [iv] Les termes « responsable » et « responsabilité » font référence, par leur étymologie, au verbe latin « respondere », et ils renvoient à la dimension de la réponse (répondre d’une chose signifie, comme le dit le dictionnaire, en être caution, en être garant). Ce qui veut dire que « être responsable » de ses actes signifie « répondre de ses actes ». La notion de responsabilité est fondatrice pour l’éthique : sans présomption de responsabilité, il n’y aurait pas de morale. La responsabilité, cependant, ne peut être toujours attribuée aux agents moraux : un acteur n’est responsable que s’il agit de façon volontaire, libre et consciente. On n’est pas, par exemple, responsable de ce qu’on ne contrôle pas : pour qu’on puisse assumer la responsabilité de ses actes (et pour qu’un tiers puisse ainsi lui attribuer une responsabilité), il faut qu’on ait le choix (d’agir ou ne pas agir) et le pouvoir d’agir, si on le veut, de façon différente. C’est pourquoi, en matière de crimes ou de délits, les auteurs peuvent être « punissables » ou « excusables » (Code pénal, II, art. 59-74) selon les circonstances de leur acte et leur état psychophysique, et que la jurisprudence pénale a été amenée à introduire le concept de « responsabilité partielle ou atténuée ». [v] La victime dans tous ses états, Anne-Françoise Dahin, Yapaka.be Autres références : https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-11.htm Formation en hypnose Ericksonienne,Thierry Melchior, formateur en hypnothérapie-année 2007-2010. » your text 09 janvier, 2026 26 octobre, 2025 06 septembre, 2025 Le triangle dépressif
Comment sortir de ce triangle ?
VOUS DEVRIEZ EGALEMENT AIMER CEUX-CI !
Le « mensonge », cet « acte parlé »
Implication de la théorie et de la recherche sur l’attachement pour la psychothérapie de l’adulte
Au cœur de la santé psychique et de l’éthique :