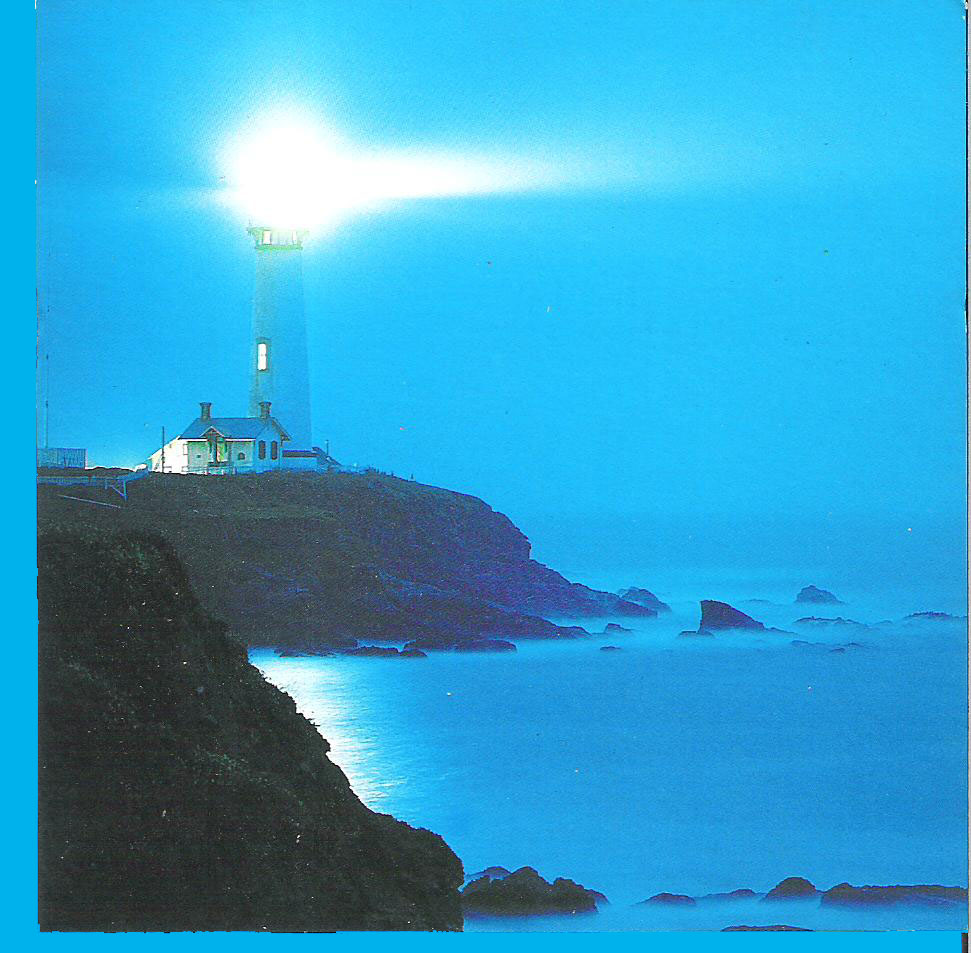Par Jacque
« Le regard est une peau pour pour la pensée » nous dit Didier Anzieu.
« J’ai besoin fondamentalement de l’autre pour savoir qui je suis » c’est ce que Jacques Lacan (1901- 1981) affirme dans sa théorie du stade du miroir. L’enfant cherche le regard : « Quand je regarde, on me voit. Donc j’existe ». Le cri du nourrisson ne devient langage que s’il est entendu par la mère. L’enfant se regarde dans le visage de la mère. L’absence de regard, d’échange créée la pathologie. Le regard est désirant. Le désir de l’un est le désir de l’Autre c’est à dire celui de la mère, nous dit lacan. Tout cela implique que le thérapeute soit visible.
» your text Alors que Sigmund Freud (1856-1939) développe le concept d’Inconscient, Jacob Levy Moreno (1892-1974) préférera nous parler de Co-Inconscient. Il va à l’encontre de la psychanalyse dont la croyance, actuellement, serait définie de la manière suivante : 1) la psychanalyse est la meilleure thérapie. 2) Plus on va profondément, mieux c’est. 3) Plus il y a de séances et plus on peut aller profond. 4) La psychothérapie serait une sous-psychanalyse. Pour Freud, l’inconscient à toujours raison. Sa vision est déterministe. Le modèle médical psychopathologique en vigueur dont fait partie le manuel psychiatrique DSM 4, d’ailleurs, ne dit rien du sujet. Au contraire, il s’impose au sujet comme un « cancer ». Le sujet réel semble évacué. Cette théorie psychopathologique où le sujet est expliqué nous amène vers une impasse. Or Moreno est beaucoup plus optimiste tout comme d’autres psychothérapeutes comme Milton H. Erickson (1901 -1980), chef de file de la célèbre école de Palo Alto. Selon cette dernière, l’inconscient révèle nos possibilités sous-exploitées, constitue une ressource, un réservoir dans lequel on peut chercher ce dont on a besoin. L’inconscient serait véritablement un allié. Nous devons donc lui faire confiance. L’inconscient peut rester inconscient. La véritable relation psychothérapeutique se ferait d’inconscient à inconscient. Communiquer avec l’inconscient, c’est la communication hypnotique. Ne serait-ce pas ce que Moreno appelle la spontanéité ? La connaissance du pourquoi n’est ni nécessaire ni suffisante. Le comment devient plus important que le pourquoi. Ce modèle représente davantage celui de l’épanouissement personnel plutôt que celui d’un déficit à réparer. La théorie du constructivisme de l école de Palo Alto s’avère très proche de celle du renversement de rôle chez Moreno. Ma réalité n’est pas celle de l’autre ! Ma carte n’est pas le territoire. Or la psychanalyse s’imposerait comme une « rencontre à sens unique », une « paranoïa dirigée ». Le problème actuel du déprimé, pathologie mentale la plus répandue sur la planète, consiste à rester exclusivement fixé sur le passé. A ce niveau on pourrait dire que les tentatives de solutions créent le problème. Au contraire, la prise en compte de l’individu, dans l’ici et maintenant, dans son contexte, une rencontre sécurisante, dans un premier temps, permet au patient de retrouver son pouvoir, de le rendre actif. On pourrait objecter à la méthode psychothérapeutique d’être trop directive. Mais une part d’influence et de suggestion est inévitable. La psychanalyse est, elle aussi, pétrie de suggestion par les interprétations. La véritable question est celle de savoir comment l’influence de la suggestion doit être traitée pour espérer que le processus thérapeutique puisse arriver, à la longue, à pouvoir en sortir. Le type de « suggestion »pour sortir de la suggestion, telle paraît plutôt être la question pertinente. Sandor Ferenczy (1873-1983) psychiatre hongrois, un des pionniers de la psychanalyse freudienne, misant sur les capacités positives, constructives du Moi, a mis au point des techniques actives élaborées avec Otto Rank(1884-1939) et Walter Georg Groddeck (1866-1934). Leur approche des patients (borderlines et pré-psychotiques) étaient devenue chaleureuse. Avec certaines personnes Ferenczy a pratiqué une analyse réciproque où le patient et l’analyste interchangaient leur rôle. De cette manière, cette technique se rapproche fort du renversement de rôle dans le psychodrame morénien. Dans la thérapie existentialiste et phénoménologique il s’agit d’un travail de co-création, de découvertes. Cette psychothérapie dite humaniste remet le sujet au centre des préoccupations. La position anthropologique de Gregory Bateson (1904-1980) comme celle de Ludwig Binswanger (1881-1966), lui-même contemporain et dissident de Freud, nous rappellent toute l’importance du contexte environnant. En effet, l’individu donne des réponses dans un contexte déterminé. Il s’agira, dès lors, de se rendre compte dans quel contexte un comportement révélé produit lui-même un sens. Nous savons très bien que la mort n’a pas la même signification en Europe qu’en Afrique. Un malade peut l’être dans un certain type de société et pas dans une autre. Même le fou a sa propre logique. Le délirant, dont Freud nous dit qu’il a toujours raison, qui en sait plus long que nous sur la réalité psychique, cherche à faire connaître la vérité de l’inconscient, l’insistance du désir. Le patient c’est celui qui sait le mieux. Cette position permanente de non-savoir du thérapeute éveille la créativité, une co-créativité. Tout ce que je ne sais pas de moi, de l’autre stimule l’originalité. Tout est, chaque fois, à réinventer. Partenaire de la relation, le thérapeute renvoie une résonance quand l’autre parle. Le thérapeute devient contexte de changement. L’approche anthropologique participe non pas d’un « comprendre » mais d’un « prendre à » c’est à dire prendre au mot, et de « prendre par » c’est à dire par le sentiment. Selon Binswanger, le thérapeute s’attachera à détecter à la fois le monde originaire du malade et la manière qu’à celui-ci d’être présent au monde. Loin de Freud, il s’agira de discerner quel type de relation le sujet entretient avec ses semblables. Dialoguer consiste, pour l’ego, à franchir la distance qui le sépare de son allocutaire. Le franchissement de la distance est réalisé ipso facto par l’établissement de la relation interlocutive. Dialoguer c’est croiser deux voix dans une parole pour produire un sens comme co-signifiance. La relation interlocutive produit donc une co-signifiance. En effet, dans son déploiement concret et quotidien, la véritable relation est « réciprocité, présence et responsabilité » au sens buberien du terme. La doctrine philosophique de Martin Buber (1878-1965) est une philosophie de la rencontre, une synthèse de l’événement et de l’éternité. La véritable rencontre n’est-elle pas une manière de vivre l’éternité dans (de) l’instant présent ? L’homme déficitaire est, avant tout, objet de sa maladie. Il est objet au sens où il est défini sur le mode du pâtir. Le corps douloureux apparaît de plus en plus comme le prolongement de malaises intérieurs prenant leur source dans la psyché. Il s’agira d’intégrer les émotions dans l’action et la parole comme dans les « ressource work » et permettre au sujet d ‘avancer dans son discours. La mise en jeu va l’y aider, déjà, dans le groupe qui fait circuler la parole et par une représentation ensuite. Cette mise en jeu peut aussi se réaliser dans une thérapie individuelle. La mise en jeu qui trouve audience auprès des autres va permettre une publication, exposer le sujet et amener, par la remémoration, une autre perspective. Elle va produire du sens qui représente la marque reçue et ce que le sujet décide d’en faire. Il s’agira de refaire quelque chose de ce qui a fait souffrir, de ce qui a manqué. Sartre nous y invite quand il dit : « il y a ce que l’on a fait de nous et ce que nous décidons nous-mêmes de faire ce qu’on a fait de nous ». Chaque être humain a en lui les clefs pour résoudre ses problèmes. La représentation psychodramatique va nous y amener. Représenter équivaut à mentaliser c’est à dire symboliser nos douleurs. Celles-ci révélées par nos humeurs, par exemple, sont, d’ailleurs, des représentations non parvenues à la conscience. L’essentiel du comportement est suscité par nos représentations. C’est ainsi que revivre les premières situations ayant structuré les relations futures permet de sortir de son enfermement. Jouer sur la scène psychodramatique (en groupe ou en situation individuelle), sur cette aire psychothérapeutique transitionnelle c’est réactualiser, réorganiser le tableau des années oubliées. Se « ré-originer permet alors de se soigner. Les nouvelles expériences vont modifier les précédentes. La personne doit muer, créer plutôt que s’accrocher. Sortir de ses prisons secrètes c’est rejouer là maintenant ce qui a pris naissance ailleurs et autrefois. Nous constatons, ici, immédiatement qu’il ne s’agit pas de nier l’inconscient car il nous rattrape : « ce dont je ne veux rien savoir m’habite et me rattrape en fait ! ». En résumé, nous pouvons donc admettre la réalité de deux concepts pertinents majeurs : l’Inconscient et le Co-Inconscient. Mots-clés : L’inconscient- le co-inconscient- le renversement de rôle- le regard- la rencontre-position anthropologique- la psychothérapie humaniste- le psychodrame en groupe et individuel- la représentation scénique- l’aire transitionnelle- le thérapeute devient contexte de changement. » your text 09 janvier, 2026 26 octobre, 2025 06 septembre, 2025

VOUS DEVRIEZ EGALEMENT AIMER CEUX-CI !
Le « mensonge », cet « acte parlé »
Implication de la théorie et de la recherche sur l’attachement pour la psychothérapie de l’adulte
Au cœur de la santé psychique et de l’éthique :